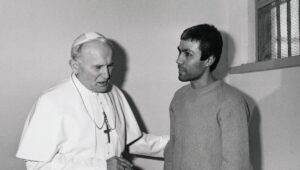Jusqu’aux années 1970 aux États-Unis, une réalité glaçante existait : les « ugly laws ». Ces législations, adoptées dès la fin du XIXe siècle, interdisaient la présence en public de toute personne jugée « malade, estropiée, mutilée ou déformée au point de constituer un objet disgracieux ou répugnant ».
Initialement introduites à San Francisco, ces lois se sont propagées dans d’autres villes comme Chicago, Portland et la Nouvelle-Orléans, dans une volonté d' »épuration esthétique ». Les motivations invoquées étaient variées : la peur infondée de la contagion du handicap, la crainte de la mendicité et de l’exploitation de la compassion publique, ou encore un simple dégoût face à une apparence jugée inesthétique, comme le soulignait Junius Henri Browne.
Ces mesures s’inscrivaient dans un contexte plus large de régulation des comportements publics et d’exclusion des populations marginalisées. Ces « ugly laws » s’inscrivent dans une période marquée par l’apogée de l’idéologie eugéniste aux États-Unis, qui prônait une hiérarchisation des individus basée sur leurs caractéristiques naturelles.
Dès 1907, des programmes de stérilisation étaient appliqués aux personnes jugées « faibles d’esprit », criminelles ou handicapées. L’héritage de ces politiques d’exclusion est encore visible aujourd’hui, certaines associations dénonçant les politiques urbaines actuelles visant à dissuader les personnes sans-abri d’occuper l’espace public, perpétuant ainsi une forme d’exclusion des plus vulnérables.
Ces lois, bien que révolues, rappellent la persistance des normes de beauté et la difficulté pour la société de faire preuve d’inclusion envers ceux qui en dérogent. Les « ugly laws », malgré leur nature discriminatoire, ont paradoxalement servi de catalyseur au militantisme pour les droits des personnes en situation de handicap.
Recevez l'actualité directement dans votre boite mail !
MERCI !
Au cours des années 1970, les activistes américains ont habilement utilisé l’existence de ces lois restrictives comme une preuve tangible de la nécessité urgente d’une protection juridique spécifique. Cette mobilisation a jeté les bases pour l’adoption de législations fondamentales telles que le Rehabilitation Act de 1973 et, plus tard, l’Americans with Disabilities Act (ADA) en 1990.
Ces textes de loi ont marqué un tournant décisif en interdisant formellement toute discrimination fondée sur le handicap dans des domaines cruciaux comme l’emploi, le logement et l’accès aux services publics, ouvrant ainsi la voie à une plus grande inclusion et à l’égalité des droits.