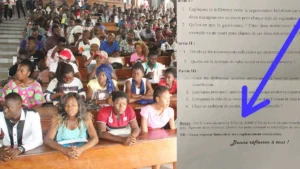Adama Smith, TikTokeur influent et doctorant en économie, décrypte dans une vidéo remarquée les racines de la pauvreté au Togo. Ce vulgarisateur explique avec pédagogie pourquoi, malgré une croissance du PIB autour de 5 % par an, la crise économique, l’insécurité alimentaire et la défiance envers l’État persistent. Voici les points clés de son analyse, étayés par des données de référence.
Pauvreté post-covid et faibles dépenses sociales
La pandémie de Covid-19 a durement frappé les foyers togolais. Le taux de pauvreté au Togo avoisinait 45 % de la population en 2022, et reste encore autour de 40 % aujourd’hui. Autrement dit, près d’un Togolais sur deux vit sous le seuil de pauvreté, une proportion qui avait bondi avec la crise sanitaire. Bien que la situation se soit légèrement améliorée récemment, la crise économique au Togo s’accompagne d’une précarité tenace, surtout en zones rurales où la pauvreté touche 58,8 % des habitants contre 26,5 % en milieu urbain.
Paradoxalement, l’intervention publique en faveur des plus vulnérables reste très limitée. Les dépenses sociales de l’État togolais sont parmi les plus faibles de la région. Les programmes officiels de protection sociale ne couvrent qu’environ 3 % de la population, là où la médiane en Afrique subsaharienne atteint 21 %. En d’autres termes, le Togo consacre près de cinq fois moins de ressources aux filets sociaux que la plupart de ses voisins africains. Ce sous-investissement social – hors éducation et santé – laisse une majorité de ménages sans aide publique, aggravant l’impact des chocs économiques sur les plus pauvres.
« Crise économique au Togo », pauvreté, protection sociale… les mots-clés reviennent dans le débat public. Adama Smith souligne que sans renforcement significatif des filets de sécurité (transferts monétaires, aide alimentaire, assurance santé), les Togolais les plus démunis restent exposés au moindre choc. La pandémie l’a illustré : faute de soutien suffisant, de nombreuses familles ont basculé dans la pauvreté. En 2022, 45 % des Togolais vivaient sous le seuil national de pauvreté, un taux que le Covid-19 avait fait grimper, et qui demeure élevé aujourd’hui. L’État a bien lancé des initiatives (comme le programme Novissi d’aide d’urgence pendant les confinements), mais celles-ci étaient temporaires et de portée limitée. Globalement, le faible effort social de l’État est pointé du doigt dans l’analyse d’Adama Smith comme un facteur aggravant de la crise sociale.
Insécurité alimentaire et fragilité de l’agriculture
Conséquence de ces failles sociales et des chocs récents, l’insécurité alimentaire s’est intensifiée. Environ un Togolais sur quatre souffre d’insécurité alimentaire à des degrés divers, et un tiers de ces personnes se trouvent même en crise alimentaire aiguë, nécessitant une aide d’urgence pour se nourrir. Fin 2022, on estimait à 568 700 le nombre de Togolais en situation de crise alimentaire (phases 3 à 5 du Cadre Harmonisé régional), sous l’effet combiné de la flambée des prix, des difficultés d’approvisionnement post-Covid et de l’insécurité dans le nord du pays. Ce chiffre a légèrement reflué pendant la campagne agricole 2023 (autour de 487 000 personnes en crise alimentaire), grâce à de meilleures récoltes de céréales. Mais la proportion de la population en insécurité alimentaire demeure élevée, aux alentours de 25 %. Dans la région des Savanes notamment (extrême nord du Togo), plus d’un habitant sur cinq a besoin d’une assistance alimentaire en urgence.
Recevez l'actualité directement dans votre boite mail !
MERCI !
Adama Smith explique que cette vulnérabilité alimentaire chronique découle de la fragilité de l’agriculture togolaise. Le secteur occupe près de 2 Togolais sur 3 et contribue à 20 % du PIB, mais il reste de type essentiellement vivrier, peu performant. Les rendements des cultures stagnent à des niveaux bas : autour de 1 tonne par hectare pour les céréales (maïs, sorgho), à peine 0,5–1 t/ha pour les légumineuses, et environ 10 t/ha pour les tubercules – des chiffres modestes qui n’ont guère progressé en 20 ans. Cette faible productivité agricole s’explique par de multiples facteurs structurels :
- Manque d’irrigation : Seulement 6 % des exploitations disposent d’un système d’irrigation. En proportion des terres cultivées, moins de 1 % des surfaces sont irriguées, le reste dépendant entièrement des pluies. Une pluviométrie aléatoire suffit donc à compromettre les récoltes, surtout avec le dérèglement climatique. Durant la campagne 2022 par exemple, le démarrage tardif des pluies et des poches de sécheresse ont sérieusement affecté certaines cultures (tomates, maïs), au point que les autorités anticipaient une baisse de rendement national. Les projections climatiques montrent d’ailleurs qu’un scénario de sécheresse marquée pourrait réduire la production agricole de 11 % par rapport à la normale. Ce risque plane régulièrement sur le Togo, où la saison des pluies tend à devenir plus courte et imprévisible.
- Faible utilisation d’intrants modernes : La majorité des petits exploitants n’utilisent pas ou peu d’engrais chimiques ni de semences améliorées. D’après les données citées par Adama Smith, environ 63 % des agriculteurs togolais ne recourent à aucun engrais chimique sur leurs parcelles. Ce taux très bas s’explique par le coût élevé des engrais, l’accès limité (malgré les subventions de l’État) et parfois une méconnaissance de leur usage. De même, seuls 10 % des cultivateurs utilisent des semences sélectionnées de qualité. La conséquence est une fertilité des sols en déclin et des rendements plafonnés. Par exemple, le maïs – céréale de base – stagne autour de 1 t/ha alors qu’il pourrait produire deux à trois fois plus avec de meilleurs intrants. En 2022, la guerre en Ukraine a provoqué une flambée du prix des engrais importés, aggravant encore la situation (le sac de 50 kg a dépassé 18 000 FCFA malgré la subvention). Beaucoup de paysans ont réduit les doses, au risque de pénaliser leurs récoltes.
- Peu de mécanisation : L’agriculture togolaise repose majoritairement sur la main-d’œuvre familiale et des outils rudimentaires. Seules 2 % des exploitations disposent de matériels motorisés pour les récoltes, et à peine 27 % utilisent des équipements mécaniques post-récolte (décortiqueuses, moulins). Le manque de mécanisation limite l’extension des superficies cultivées par travailleur et laisse les agriculteurs dépendants de méthodes manuelles peu efficaces.
Ces faiblesses structurelles rendent le pays vulnérable aux chocs et à l’insécurité alimentaire. À la moindre sécheresse ou inondation, la production nationale souffre. En 2021–2022, la combinaison de mauvaises pluies et de l’envolée des prix des intrants a plongé plus de 568 000 Togolais en crise alimentaire fin 2022. L’amélioration relative de la campagne 2023, grâce à une pluviométrie plus clémente, n’a pas suffi à dissiper cette insécurité : un quart de la population reste sous-alimenté ou mal nourri.
Croissance économique vs déclin de la productivité
Malgré ce sombre tableau social, le Togo affiche officiellement une croissance économique soutenue depuis quelques années. Le PIB a augmenté en moyenne d’environ 5 % par an sur la dernière décennie, avec une accélération récente : +6,1 % par an en moyenne entre 2021 et 2023. Même en 2020, en pleine pandémie, le Togo a évité la récession. En 2024, la croissance du PIB a été de 5,3 %, et les projections tablent sur ~5 % en 2025. Ce dynamisme s’explique en partie par des investissements publics (routes, infrastructure logistique) et des réformes ayant amélioré le climat des affaires sur le papier. Lomé a par exemple beaucoup misé sur son port en eau profonde – devenu un hub régional – et sur la plateforme industrielle d’Adétikopé pour attirer des usines d’assemblage.
Cependant, Adama Smith souligne que cette croissance économique» ne se traduit pas par un développement inclusif. Le paradoxe togolais, c’est une croissance « en trompe-l’œil » tirée par quelques secteurs et grands projets, alors que la majorité de la population n’en ressent pas les bénéfices. En réalité, la productivité de fond de l’économie togolaise stagne, voire recule.
Un indicateur éloquent est la productivité globale des facteurs (PGF) – une mesure de l’efficacité avec laquelle le capital et le travail produisent des richesses. Au Togo, la PGF est en déclin depuis 2013, signe que la croissance repose davantage sur l’accumulation de ressources (investissements, main-d’œuvre) que sur des gains d’efficacité. Plus alarmant encore, la productivité agricole est retombée à un niveau à peine supérieur à celui du début des années 1960. D’après un rapport de la Banque mondiale, le niveau de PGF dans l’agriculture togolaise est aujourd’hui quasiment équivalent à celui du début de l’Indépendance, plus de 60 ans en arrière. Autrement dit, l’efficacité de l’agriculture togolaise n’a pas progressé depuis des décennies, et aurait même régressé sur la dernière décennie. Adama Smith illustre ce constat en citant l’exemple agricole : malgré les progrès technologiques disponibles dans le monde, un agriculteur togolais moyen produit à peine plus (par hectare ou par heure de travail) qu’un agriculteur togolais en 1961. Cette stagnation de long terme est attribuable au manque d’investissement dans la modernisation (irrigation, machines, intrants), à la faible formation des agriculteurs, ainsi qu’aux obstacles structurels comme l’accès difficile au crédit ou au foncier.
En dehors de l’agriculture, d’autres secteurs n’échappent pas à cette faible productivité. Le secteur informel prédomine (près de 90 % des emplois), souvent avec de très petites activités peu productives. L’industrie reste embryonnaire, limitée à quelques unités (cimenteries, brasseries, phosphates, montage d’assemblage) et ne décolle pas en termes de valeur ajoutée technologique. Le spectre de la “croissance sans développement” plane donc sur le Togo : une croissance du PIB entraînée par quelques investissements (souvent étrangers) et l’exploitation accrue des ressources (terres, mines), sans transformation structurelle de l’économie. Cela explique que la croissance n’ait pas fait reculer la pauvreté aussi vite qu’espéré : le taux de pauvreté baisse très lentement (il était encore autour de 45 % en 2019). Les inégalités restent marquées et les emplois décents rares, ce qui nourrit frustration et sentiment que “la croissance profite à une minorie”.
Adama Smith insiste ainsi sur la nécessité d’améliorer la productivité pour une croissance inclusive. Investir dans l’agriculture (irrigation, engrais, formation), soutenir les PME, développer la transformation locale des matières premières… sont autant de pistes pour que la croissance économique se traduise en créations d’emplois et en hausse du niveau de vie pour la majorité. Faute de quoi, le contraste restera saisissant entre les statistiques macroéconomiques flatteuses et la réalité vécue par la population.
Corruption, gouvernance et défiance envers l’État
La situation économique du Togo est intimement liée à son contexte politique et institutionnel. Sur ce plan, Adama Smith évoque une crise de confiance des citoyens envers l’État togolais et ses dirigeants. Le pays est dirigé depuis 2005 par le président Faure Gnassingbé, successeur de son père Gnassingbé Eyadéma (qui avait lui-même régné pendant 38 ans). Cette longévité au pouvoir de la même famille – plus de 55 ans de règne Gnassingbé ininterrompu – s’est accompagnée d’un affaiblissement démocratique et d’une concentration du pouvoir. Malgré quelques ouvertures (élections locales en 2019, création récente d’un poste de Premier ministre), le régime est régulièrement accusé de verrouiller les institutions et de réprimer l’opposition.
Depuis 2017 surtout, une contestation populaire périodique émerge pour réclamer l’alternance politique. Des manifestations massives ont eu lieu entre 2017 et 2018, réprimées sévèrement, et la défiance envers le président reste vive dans une partie de la population. En juin 2023 encore, des protestations citoyennes ont éclaté malgré leur interdiction, signe que la contestation de Faure Gnassingbé persiste sur les réseaux sociaux et dans la diaspora, sinon dans la rue. Cette crise de confiance politique a des conséquences économiques directes : elle ternit l’image du pays et peut dissuader des investisseurs étrangers inquiets de la stabilité du cadre politique.
Par ailleurs, la corruption et le manque de transparence dans la gestion publique minent la crédibilité de l’État. Le Togo se classe parmi les mauvais élèves en matière de gouvernance. Selon l’indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International, le pays n’obtient qu’un score de 31/100, se situant au 121e rang sur 180 pays (un rang quasi inchangé ces dernières années). Ce score reflète une corruption endémique dans l’administration et les marchés publics. De fait, de nombreux témoignages font état de gaspillages de fonds publics, de faiblesses dans l’état de droit et d’une justice peu indépendante, autant de facteurs qui érodent la confiance des citoyens et des opérateurs économiques. La gouvernance togolaise est régulièrement pointée du doigt pour son manque de transparence et l’impunité dont bénéficient certaines élites. Par exemple, le rapport 2022 de la Cour des comptes togolaise a révélé des irrégularités dans la gestion de certains ministères et entreprises publiques, sans suites judiciaires claires. Ce climat contribue à un déficit de confiance : les Togolais doutent de l’utilisation équitable des ressources publiques, et les entreprises étrangères redoutent les pratiques opaques ou clientélistes.
Adama Smith établit le lien entre cette gouvernance perfectible et l’attractivité économique du pays. Si les bailleurs de fonds internationaux ont salué certaines réformes (le Togo a grimpé dans le classement Doing Business en simplifiant la création d’entreprise, par exemple), ils restent attentifs à la stabilité politique et aux efforts anti-corruption. Or, tant que la crise politique couve et que l’État de droit est fragile, le risque-pays perçu demeure élevé. Des investisseurs étrangers hésitent à s’engager sur le long terme, craignant des revirements politiques ou des pratiques anti-concurrentielles. De même, la diaspora togolaise – pourtant source potentielle d’investissements et de transfert de compétences – peut se montrer réticente à investir si elle n’a pas confiance dans les institutions nationales.
En synthèse, l’analyse d’Adama Smith met en lumière un cercle vicieux où économie et politique se mêlent. La stagnation socio-économique alimente la grogne sociale et la contestation de l’ordre établi. En retour, l’instabilité politique et la mauvaise gouvernance freinent les progrès économiques en décourageant l’initiative et l’investissement. Pour sortir de cette ornière, l’économiste estime que des réformes structurelles doivent être menées de front : renforcer l’État de droit, améliorer la transparence budgétaire, et restaurer la confiance avec la population. Sans cela, les efforts purement économiques risquent d’être compromis par un climat de défiance envers l’État.
Vers une sortie de la pauvreté au Togo ?
Le tableau dressé par Adama Smith est préoccupant, mais il ouvre aussi des pistes d’action. Investir dans le capital humain (éducation, santé, protection sociale) est crucial pour réduire la pauvreté et accroître la productivité. Le Togo accuse un retard certain, avec un indice de développement humain le classant 162e sur 191 pays, mais des marges de progression existent. De même, moderniser l’agriculture (irrigation, mécanisation, intrants) pourrait transformer ce secteur clé et assurer la sécurité alimentaire, tout en créant des emplois en milieu rural. Sur le plan institutionnel, lutter contre la corruption et engager un dialogue politique inclusif seraient de nature à restaurer la crédibilité du pays.
En attendant, la jeunesse togolaise – principal public d’Adama Smith sur TikTok – se montre de plus en plus attentive à ces enjeux. Informée et connectée, cette génération de 18-35 ans exige des comptes et aspire à un changement, aussi bien économique que politique. La vulgarisation économique d’Adama Smith rencontre un écho favorable auprès d’elle, car elle met des chiffres et des faits sur des ressentis quotidiens (cherté de la vie, chômage, exode rural, etc.). Son message aux autorités est implicite : sans une prise de conscience urgente et des réformes courageuses, la crise économique togolaise pourrait s’enliser et attiser davantage les tensions sociales.
En définitive, le diagnostic posé est clair. Le Togo, malgré son potentiel (position géographique stratégique, population jeune, terres arables, ressources minières), reste empêtré dans une crise économique et sociale aux causes multiples – pandémie, faiblesses structurelles, gouvernance. La vidéo d’Adama Smith appelle à regarder ces réalités en face pour mieux y remédier. Il appartient désormais aux décideurs togolais de s’en inspirer afin d’engager le pays sur la voie d’une croissance inclusive et durable, seule à même de réduire la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la défiance qui minent aujourd’hui la société.
Sources : Banque mondiale, FMI, FAO, Transparency International, Cadre Harmonisé (PAM), Afrobarometer